— Doc ! Magnez-vous ! crie Timothée en faisant irruption dans ma baraque. C’est l’heure de la loterie !
Le gamin n’attend pas ma réponse. Il est déjà parti en faisant voler mon rideau de perles de bambou. L’insouciance de la jeunesse, je l’ai vécue aussi. Tout comme lui, je vivais la loterie comme une fête, autrefois. Mais comment peut-on appeler ça une fête, quand on sait que quelqu’un va mourir ?
Comme toutes les deux mille cent quatre-vingt-dixièmes heures, et pas une minute de plus ni moins, toute la poisseuse colonie d’ici-bas doit se réunir sur la grande place. Une partie s’y rend par espoir, d’autres, comme moi, par pur devoir. Pour gagner une place dans la colonie d’en haut, certains sont prêts à tout, même s’il faut pour cela que quelqu’un soit condamné à mourir. La loi du « chacun-pour-soi », en ce qui me concerne, elle me donne envie de gerber. Mais bon, je n’ai pas non plus envie de crever bêtement pour crime de désobéissance. Alors, quand faut y aller, faut y aller.
Je me décrasse vite fait devant mon carré de miroir, cinquante centimètres de côté, pas plus, ni moins. C’est bien assez pour entretenir une tronche à peu près potable. Sûr qu’à 48 ans, je ne suis plus de première fraîcheur pour lever les minettes, mais les combats de rue ne m’ont pas trop amoché. Deux trois balafres, un nez tout écrasé et bosselé, rien de bien effrayant, mais juste ce qu’il faut pour imposer le respect. Dans la colonie d’ici-bas, le respect, ça peut vous sauver la vie. Être taillé comme une armoire et avoir des enclumes à la place des mains, ça aide aussi.
Quand je sors de ma baraque, la douzième rue est bondée, comme les onze autres. Une marée vaguement humaine, si noircie par la crasse que l’on peine à deviner l’âge ou le sexe des gens, s’écoule lentement de l’artère jusqu’à la grande place, au centre de la colonie. L’air est déjà difficilement respirable dans la ville souterraine d’ici-bas, mais là, dans une telle foule, on suffoque. À chaque nouvelle loterie, c’est le même foutoir. De dépit, je m’engage dans le flux.
— Bonjour, Doc.
— Mes respects, Doc.
— Comment vous portez-vous, Doc ?
Ha oui, c’est vrai. Cette fois-ci, je fais partie des mille adultes éligibles à la loterie. J’ai une chance sur mille d’accéder à la colonie d’en haut, mais aussi une chance sur mille de devoir donner un nom : celui de la personne à bannir dans le monde d’en-dehors ; un euphémisme pour dire « condamner à mort ». Par conséquent, j’ai droit au concert d’hypocrisie, au bal des faux derches. Tout le monde veut entrer dans mes bonnes grâces. Sincèrement, ce n’est pas bien difficile avec moi. Parce que je suis le Doc.
Avec ma carrure et ma gueule de boxeur poids lourd, mon physique m’aurait donné un solide avantage dans le crime, mais il en a été tout autre. Je suis né dans cette colonie. Ce n’est pas la gloire, mais je ne m’en plains pas. Cela aurait pu être pire. Il paraît que d’autres colonies se sont créées un peu partout sur Terre après le cataclysme. Une vingtaine selon les rumeurs. Dans certaines d’entre elles, les hommes seraient revenus à l’état sauvage. On parlerait même de cannibalisme. Ici, même si nous souffrons parfois de la faim, nous n’en sommes jamais rabaissés à de pareilles monstruosités.
Pourtant, au fil des années, j’ai observé peu à peu la déliquescence de la colonie. Les gamins se désintéressent de l’instruction et s’adonnent de plus en plus jeunes à toutes sortes de crime. Je ne parle pas du petit vandalisme, mais de vols, de meurtres et même de viols commis par des enfants, bordel !
Faire miroiter une place dans la colonie d’en haut, cela a bien fonctionné les premières années, mais à la longue, les gens finissent par se lasser de ces occasions trop rares, des chances minimes. Quatre gagnants par an, c’est trop peu. Sans parler du risque d’être banni à chaque loterie. Question relations humaines, les jeux sont faussés. Nous nous montrons amicaux les uns envers les autres non par envie, mais par pur intérêt : celui de ne pas être nominé par le gagnant de la loterie. S’embrouiller avec quelqu’un, c’est risquer la mort si jamais il gagne à la loterie.
Par ailleurs, le moindre crime, du simple vol au meurtre, vous garantit une exclusion à vie de la liste des éligibles à la loterie. Perdre toute chance d’accéder à une vie meilleure dans la colonie d’en haut, cela peut en décourager certains, mais, quand la faim vous lacère le ventre, personne n’a envie d’attendre deux mille cent quatre-vingt-dix heures.
Les dirigeants de la colonie, avec ce système, pensaient garantir la paix et élever la société humaine à une vie vertueuse, lavée de tout vice, tout en opérant une sorte de sélection naturelle en éliminant les indésirables sans se salir les mains. Mais la peur ne suffit pas à discipliner toute une population. La soupape finit toujours par sauter un jour ou l’autre. J’ai lu suffisamment de bouquins pour m’en rendre compte.
Un tel système induit un effet pervers plus grave encore : il interdit l’amour. Comment s’autoriser à aimer quelqu’un, si l’on a peur de le perdre à cause de la loterie ? Quand on gagne, on ne peut emmener personne. Ni femme ni enfant. Le droit de fonder une famille n’appartient qu’aux colons d’en haut. Ça, c’est trop demander à la nature humaine. Beaucoup préfèrent encore commettre le crime d’avoir des enfants ici-bas, et se condamner à vivre perpétuellement dans la ville souterraine. Ceux d’en haut pensent que les bébés ici naissent par accident : en réalité, c’est un acte de rébellion.
C’est ainsi que je suis né ici. Je suis tout à la fois un enfant de l’amour et un doigt d’honneur au système. Encore heureux, les enfants sont d’office exclus de la loterie jusqu’à leur majorité. Ceux d’en haut nous accordent encore le droit de grandir avec nos parents.
Ma mère, je l’ai peu connue. Elle s’est fait bannir dans le monde d’en-dehors suite à une loterie. Une stupide histoire de jalousie, paraît-il. « Son seul crime a été d’être trop belle », se désolait mon père. Oui, des fois, le bannissement tient à peu de chose. C’est à en devenir cinglé.
C’est mon père qui m’a élevé. Un colosse, lui aussi. Je tiens ma carrure de lui, mais la douceur dans les yeux, elle me vient de ma mère, m’a-t-on dit. D’un seul regard, raconte-t-on, elle parvenait à apaiser une âme en peine. De mes parents, j’ai hérité tout à la fois la force et la douceur.
« Cette ville manque de personnes de valeur », s’est confié un jour mon père à moi, alors que je devais avoir environ 9 ans. « Franck, mon fils, promets-moi de toujours œuvrer dans ta vie pour devenir un homme de valeur.
— Comment, papa ?
— Ne fais pas comme la plupart des gens ici. La meilleure façon d’atteindre la vertu est d’agir de façon désintéressée. Ne cède pas au mal et sème le bien autour de toi, non par intérêt, mais par choix. Ce n’est qu’ainsi que tu apprécieras pleinement la valeur de ta vie.
— Mais si un jour quelqu’un me nomme à la loterie, j’aurais tout perdu, non ? »
Les lèvres de mon père ont esquissé ce sourire énigmatique qui me fascinait tant, et il m’a répondu : « Tu n’auras rien perdu et tout gagné. »
Ce jour-là, même si je n’ai pas tout compris, je lui ai promis de devenir un homme de valeur. Toute ma vie, même après la mort de mon père, je me suis tenu à cette promesse. J’use de ma force et de ma douceur pour construire la paix autour de moi.
Je calme les bagarres de rue, quitte à me prendre moi-même des coups. Je joue avec les gamins et les incite à s’instruire. Je fais l’amour quand j’en ai envie, pas quand j’en ai besoin. J’écoute sans jamais juger. Je travaille beaucoup et lis énormément. Mon seul regret dans ma vie est de ne pas savoir jouer d’instrument de musique : mes gros doigts tout patauds sont aussi doués de finesse qu’un hippopotame montant de la dentelle au crochet.
Bref. Je suis le Doc : le mec qui soigne. À défaut de guérir le corps, je guide les âmes perdues. Il a suffi qu’une fois quelqu’un me surnomme le Doc pour que ce soit repris par tout le monde. Seuls les intimes m’appellent encore Franck. Avec le temps, je m’y suis fait. Cela m’amuse plus qu’autre chose.
Nous parvenons enfin au centre de la ville. Sur l’écran géant, toujours le même film, celui qui vante la vie dans la colonie d’en haut. Tout est lumineux, propre, beau… Là-haut, il ne semble y vivre que de jeunes gens à la silhouette sportive, élevant des enfants très propres sur eux. Trop propres même. Dans les bas-fonds, c’est du jamais vu. Des adultes aux dents aussi blanches et des enfants aussi peu sales, c’est louche. Ce qui fait moins rêver aussi, c’est ce peloton de soldats vêtus de noir et entièrement masqués par un casque à visière rouge, qui attendent au pied de l’écran, matraque à la main. Du coup, le film sonne un peu faux, comme qui dirait.
Ces images pourléchées, de toute façon, je les connais par cœur. Cela fait trente ans qu’ils n’ont pas fait l’effort de les renouveler. Elles suffisent pourtant à allumer des étoiles dans les yeux de certains, de les faire trépigner et suer à grosses gouttes. Ils sont tous là, le regard captivé par l’écran, à espérer vivre enfin le jour où tout basculera pour eux. Avoir la foi, c’est croire qu’on se transformera en rose lors même qu’on n’est qu’un foutu pissenlit sur une bouse de vache. C’est beau, la foi.
— Qu’est-ce que ce doit être bien de respirer un air pur à 80 %, quand même ! rêve mon voisin de droite.
— Et manger à sa faim, surenchérit mon voisin de gauche. De vrais fruits, de vrais légumes, de la vraie viande…
Clair que je ne cracherais pas sur un steak de bœuf. Les bouillies de céréales et les barres reconstituées, ça va bien.
Le compte à rebours est lancé. On va enfin découvrir le nom du gagnant. Dix… Neuf… Huit… Sept… Six… Cinq… Quatre… Trois… Deux… Un… Oh… pu… tain.
L’écran affiche en grand mon nom et ma tronche, dans un carré de cinq mètres de côté. Cela me change des cinquante centimètres, et je me rends compte que je ne suis plus si potable que ça. Mais cela encore, je m’en contrefous. Le monde devient flou autour de moi, tout n’est que vague brouhaha, et mes jambes, bordel, pourquoi ai-je l’impression d’être monté sur des échasses et que je vais me casser la gueule ?
Les gens autour de moi me félicitent et me tapent dans le dos. « Bravo Doc, c’est mérité ! », me lance le jeune
Timothée. Je sais qu’en disant ça, il est sincère. Beaucoup le sont d’ailleurs. « Félicitations », me lance, tout sourire, un autre gars, à qui j’ai pourtant refait le portrait il n’y pas deux semaines. Lui, il n’est pas sincère : il a juste peur pour sa pomme.
Trois soldats se détachent du peloton et fendent la foule sans ménagement pour me rejoindre. Deux se placent derrière moi, l’autre m’invite à le suivre d’un geste de la main, sans un mot. Je ne suis pas du genre contrariant : j’y vais.
La foule commence déjà se disperser. Trop tard pour les au revoir. J’aimerais parler à mes amis une dernière fois. Leur dire que ça va aller. Que la chance tournera pour eux aussi. Après tout, je n’y croyais pas non plus. « Ça n’arrive qu’aux autres », que je pensais. Et bah non, voyez ! La preuve que je me suis royalement planté. Mais les soldats me pressent le pas. Ceux d’en haut n’aiment pas faire traîner la cérémonie. L’abus d’émotion est dangereux pour la santé, doivent-ils penser. À consommer avec modération.
Dépités, les gens retournent dans leurs baraques, à l’école, au turbin. Pas un regard ne se croise, mais nous nous donnons silencieusement rendez-vous dans deux mille cent quatre-vingt-dix heures. Sauf pour celui ou celle qui se fera jeter aujourd’hui dans le monde d’en-dehors. Cette personne-là n’a que plus que six heures à vivre. Mes amis n’ont rien à craindre, mais j’en connais quelques-uns qui ne doivent pas en mener large en ce moment. Ceux-là ont de bonnes raisons de craindre que je donne leur nom, et, quelque part, rien que d’imaginer leur état me procure une satisfaction coupable. Cela donne un je-ne-sais-quoi de sentiment de puissance. Un foutu vertige, oui. Est-ce cela que l’on ressent quand on a un droit de vie ou de mort sur quelqu’un ?
Les soldats m’entraînent à l’hôtel de ville. Juste une baraque un peu plus grosse que les autres. Là, je croise monsieur l’administrateur de la colonie d’ici-bas. Depuis que je suis le porte-parole de la douzième rue (non pas que j’en avais envie, mais personne ne voulait s’y mouiller), je ne suis pas bien vu à l’hôtel de ville. Je suis en quelque sorte leur bête noire. Sûr qu’ils se passeraient bien de nos doléances, ces gens-là. Ils n’aiment pas quand les administrés râlent : ça les empêche de tourner en rond. Que monsieur l’administrateur soit tranquille : son poste lui assure l’immunité à la loterie. Personne ne peut le nommer. Bien pratique pour détourner les fonds au nez à la barbe de tout le monde.
— Félicitations, me lance-t-il avec un large sourire. Vous allez beaucoup nous manquer.
C’est cela, oui.
Les soldats m’emmènent ensuite devant une grande et belle porte blanche à double battant. Elle en impose avec ses ornements sculptés et ses poignées dorées. C’est tout juste si l’on n’oserait pas y toucher. Le premier soldat toque. On entend une voix de femme qui nous dit d’entrer. Le soldat ouvre la porte, j’entre, et même si je ne suis pas encore en haut, me voilà déjà dans un autre monde.
Ce qui frappe aux yeux, c’est l’omniprésence du blanc, du sol au plafond, sans aucune fenêtre. Pas de décoration ni de mobilier, hormis un bureau et deux chaises, blancs évidemment. Du plafond entier émane une lumière lactescente. Cette pièce est totalement irréelle. Il n’y a aucun point de repère. Je ne saurai même pas dire si la pièce est grande ou petite. Tout ce que je sais, c’est que je suis à l’intérieur d’un cube blanc.
Pour un peu, on pourrait se croire à l’orée du paradis, avec Saint-Pierre qui vous attend derrière un bureau pour vous jauger. Le Ciel ou le Purgatoire ? Sauf qu’ici, il s’agit d’une femme, accoudée à la table et mains jointes sous son nez. Visiblement, elle m’attend.
La porte se referme derrière moi. Mal à l’aise, je m’avance et m’arrête devant le bureau. Je me tiens debout, face à cette femme qui ne me lâche pas du regard. J’attends qu’elle m’invite à m’asseoir. Je suis poli tout de même.
De toute ma vie, je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu’un d’aussi glacial. Grande et mince, le visage émacié, d’une pâleur presque maladive, elle pourrait être séduisante avec ses cheveux courts, à la garçonne, d’un blond platine. Elle pourrait seulement. On a beau avoir à peu près le même âge, je ne me risquerais pas à la séduire. Ses yeux sont d’une d’une telle froideur qu’on ne peut s’empêcher de dévier notre regard par peur de geler sur place.
Elle me scrute, de la tête au pied, et, subtilement, son sourcil dessine un arc de mépris. J’entends même un petit souffle de dédain. Bon. Je crois que j’ai raté l’audition pour leur prochain clip.
— Asseyez-vous, dit-elle enfin d’une voix monocorde.
Pas trop tôt. Je m’exécute. Devant elle, un dossier est posé, grand ouvert, sur la table. Il y a ma photo et beaucoup de mots, étalés sur trois ou quatre pages. Je me demande bien ce qu’ils peuvent avoir d’aussi intéressant à raconter sur moi. Elle lit en diagonale le dossier, soupire de temps en temps, puis le referme vivement comme l’on claquerait la porte à un vendeur ambulant.
— Un nom ? me lâche-t-elle sèchement.
— Non.
— Comment ça, non ? tique-t-elle. Vous avez un nom, oui ou non ?
— Non.
— Vous ne savez pas qui nommer ou vous vous payez ma tête ?
— Sauf votre respect, m’dame, ni l’un ni l’autre.
La madame semble interloquée. Ses lèvres sont prises de soubresauts nerveux qu’elle tente de dissimuler en balbutiant : « Hé bien… Hé bien… Voyons… » Il lui faut un petit moment pour se retrouver une contenance. Coudes posés sur la table, mains de nouveau jointes sous son nez, elle m’adresse la parole sur un ton vaguement doucereux, sûrement menaçant, comme une maîtresse d’école parlerait à un enfant fautif.
— Pourquoi ne voulez-vous pas donner un nom ?
— Pourquoi pas ? lui ai-je rétorqué un brin provocateur.
Légères palpitations des narines. Je l’agace.
— N’usez pas de ma patience, Franck, me répond-elle irritée. Ou préférez-vous plutôt que je vous appelle « Doc » ? Bien qu’aucune compétence ni aucun titre ne vous en donnent le droit, ajoute-t-elle avec mépris.
En guise de réponse, elle n’a droit qu’à un haussement des épaules de ma part.
— Je vous appellerai donc Franck. Pourquoi ne pas donner un nom ? Je vais vous expliquer pourquoi. Votre acte de désobéissance sera perçu comme un crime, et, comme il faut que quelqu’un soit banni aujourd’hui, c’est vous qui le serez. Personne ne montera dans la colonie d’en haut, et vous, vous perdrez la vie. Avouez que ce serait du gâchis, non ? Alors ? Toujours pas de nom à donner ? Vous en êtes sûr ?
Je m’approche doucement de la table pour y poser mes bras croisés. Elle a dû penser que j’allais l’agresser, car elle enlève aussitôt ses coudes et se tient maintenant raide contre le dossier de sa chaise. Avec ma carrure, facile de penser que je vais vous cogner. Je dois avouer aussi que c’est tentant, histoire de lui faire ravaler son ton condescendant à deux balles.
— Je vais vous dire un truc, m’dame, lui dis-je calmement. J’ai fait une promesse à mon père quand j’étais môme.
Je lui ai promis que je deviendrai une personne de valeur plus tard. Expliquez-moi quelle valeur peut avoir un homme qui peut, sans scrupule, envoyer quelqu’un à la mort pour… pourquoi au juste ? Mieux respirer ? Mieux manger ? Mieux vivre ? Même pour échapper à la mort, je ne voudrais pas donner un nom. Qui suis-je pour décider que quelqu’un mérite mieux de vivre qu’un autre ? Je n’ai pas la prétention de me prendre pour Dieu, avec tout le respect que je vous dois, m’dame.
— Il ne s’agit pas de se prendre pour Dieu, Franck, me répond-elle sans se laisser décontenancer. Mais de faire un geste citoyen. Vous rendez un service à la société en la débarrassant d’un indésirable. Vous élevez l’humanité en nous aidant à sélectionner les meilleurs et éliminer les plus faibles.
— Ça, c’est ce qu’on appelle la sélection naturelle. Comme son nom l’indique, c’est à la Nature de faire cette sélection. Pas à nous.
— La Nature, parlons-en ! rebondit-elle sur ma réponse. Elle ne fera que peu de cas de vous dehors. Savez-vous ce qui vous attend là-bas ? Depuis le cataclysme, les bêtes sauvages dominent toute la surface de la Terre. Ce sont devenus de véritables monstres. Sans compter sur l’air qui est vicié et vous brûlera les poumons. Vous en cracherez du sang, à moins que vous ne vous fassiez croquer avant de vous en rendre compte. Alors, elle est belle votre sélection naturelle ! Toujours prêt à mourir pour elle ?
Pas envie de lui répondre.
— Vous êtes donc vraiment prêt à perdre la vie plutôt que de donner un foutu nom ? s’impatiente-t-elle en me pointant du doigt.
— Personne n’est prêt à perdre la vie, mais je ne suis pas près de perdre mon âme.
Elle éclate de rire, malgré elle. Non pas qu’elle m’ait trouvé drôle, mais parce qu’elle est désorientée. Elle regarde autour d’elle, comme pour chercher un témoin de l’absurdité qu’elle vient d’entendre.
— Vous êtes têtu, finit-elle par lâcher comme un constat.
— C’est mieux qu’être lâche.
Elle se secoue la tête, comme pour se réveiller d’un mauvais rêve. Elle revient un moment sur mon dossier, l’ouvre, le parcourt. Que cherche-t-elle ? Une mention « Malade mentale » ? « Bon à interner » ? Elle ne me comprend pas. Ça saute aux yeux. Il lui faut à tout prix trouver une raison, une logique, à mon comportement. Vas-y, ma belle. Tourne les pages autant de fois que tu le voudras. Ils t’ont tellement lavé le cerveau avec leur propagande que tu ne peux pas me comprendre.
— Je ne comprends pas, avoue-t-elle. Comment pouvez-vous cracher sur une telle chance ? La loterie est une formidable opportunité pour…
— Un foutu leurre, oui ! l’ai-je coupée. Je vais vous raconter un truc, m’dame. Avant le cataclysme, les gens aimaient aussi participer à la loterie. C’était différent à l’époque. On n’y perdait pas la vie. On gagnait de l’argent. Souvent de petites sommes. Et parfois, rarement, un pauvre diable gagnait tellement d’argent qu’une vie ne suffirait pas à tout dépenser. Mais quand on y réfléchit bien, la loterie d’aujourd’hui, c’est du pareil au même. Vous vendez du rêve au prix fort. Avant, il fallait payer pour participer. Pas grand-chose, mais, pour les plus démunis, un peu c’était déjà beaucoup. L’argent, quand on est pauvre, c’est la vie. Et certains n’hésitaient pas à se saigner les quatre veines. Pourquoi ? Pour avoir le droit de rêver ? Alors, oui, quand on gagnait à la loterie, c’était déjà au prix de la vie des autres. Rien n’a changé. Au moins, avec vous, il n’y a plus d’ambiguïté. Alors votre rêve, je n’en veux pas. Je préfère encore vivre en enfer les mains propres, plutôt qu’au paradis du sang aux mains.
Comme pour appuyer mes propos, je lui montre mes mains. Elles sont calleuses, abîmées par des années à trimer au turbin et à cogner les têtes carrées, mais, mes pognes, elles sont impeccablement propres.
— Votre discours est déconcertant, concède-t-elle. Vous semblez plus instruit que la moyenne. C’est étonnant pour…
— Pour un ouvrier ? lui ai-je suggéré.
— Où avez-vous appris toutes ces choses ? me demande-t-elle sans me répondre. Cette façon de s’exprimer… La sélection naturelle… La loterie d’avant…
— Ce sont les vieux qui me racontaient.
Je préfère mentir plutôt que de lui parler de ma passion pour les livres. Elle serait capable d’ordonner qu’on les brûle tous.
— Ha oui ? s’étonne-t-elle sans y croire. C’est vrai. Vous êtes une progéniture non autorisée de deuxième génération. (Tu sais ce qu’elle te dit la « progéniture non autorisée » ?) Vous avez connu la première génération, celle d’avant le cataclysme. Ils ont dû vous en raconter de belles histoires, vos vieux.
Elle me regarde d’un air navré. Je crois qu’elle rend enfin les armes. Elle fait claquer sa langue de dépit, signe un truc dans mon dossier et se lève. Elle ouvre la porte et parle à voix basse à l’un des soldats. Elle me jette un dernier regard, chargé de mépris, et disparaît de ma vue. Les soldats entrent et m’attrapent sans ménagement les bras pour me traîner de force dehors.
Une fois sortis de l’hôtel de ville, nous nous dirigeons vers la grande porte rouillée, celle qui mène au monde d’en-dehors. D’accord les gars. Faites vite, qu’on n’en parle plus. Un des soldats du bataillon posté au pied de l’écran géant s’empare d’un micro et sa voix résonne aussitôt dans toute la colonie d’ici-bas.
— Avis à la population. Ce jour du 24 février 2099, Franck Charpentier, alias « Doc », après examen de ses faits et gestes recensés dans le passé, est jugé illégitime à la loterie, et banni de la colonie d’ici-bas, reconnu coupable d’incitation à la violence. Vous êtes priés de ne pas entraver la sentence et laisser nos services effacer ses affaires personnelles. Toute personne surprise à receler chez elle des affaires appartenant au condamné sera jugée pour complicité. Terminé.
Ils ne veulent surtout pas dire que j’ai refusé de donner un nom. Faudrait pas en inspirer d’autres. Ils préfèrent me faire passer pour une sorte d’anarchiste clandestin, le genre de mec tout bien tout propre en apparence, mais cachant des bombes sous le lit. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que personne ne gobera ces salades. Incitation à la violence, je rêve. Mais bon, qu’est-ce que ça changera de savoir ou pas la vérité ?
Devant cette porte immense, je me dis que j’y suis. Ce fameux jour que l’on attend, que l’on craint. Celui où toute la vie bascule. Une naissance, un accident, un voyage… Dommage que ce jour soit celui de ma mort.
Les soldats établissent un périmètre de sécurité à bonne distance derrière moi. Quelques personnes se risquent à venir assister à mon départ. Pas des badauds, mais des amis. Des gens que j’ai aidés. Des faibles que j’ai défendus.
Des malheureux que j’ai écoutés sans juger. Des femmes à qui j’ai fait l’amour quand on en avait envie. Des gamins avec qui j’ai joué et que j’ai incités à s’instruire. Ils sont de plus en plus nombreux à venir. Je ne saurais les compter, mais je jure que je les connais tous. Certains pleurent, d’autres serrent les poings.
Timothée, ce brave môme, n’y tient plus et tente de franchir le périmètre, mais un coup de matraque dans le dos le fait s’écrouler au sol. Il me jette un regard suppliant. Le mien lui dit de ne pas insister. Ça va aller, pourraient dire mes yeux.
Le chef des soldats s’impatiente et ordonne l’ouverture de la porte. Celle-ci pousse une longue plainte métallique, et laisse bientôt entrer une brise glaciale ainsi qu’une lumière éblouissante. On me pousse dehors. La porte se referme. Rapide. Simple. Comme un coup de hache qui vous décapite.
Le voilà donc ce fameux monde d’en-dehors. Le froid qui me saisit me pétrifie et me jette au sol. À moins que ce ne soit l’effet de l’air vicié ? À genoux, je lutte pour respirer. Ma voix se fait rauque. Ma trachée me fait mal.
C’est Dame Nature qui m’oblige à m’incliner devant elle. Première épreuve. Serai-je digne d’être épargné ? Je lutte, chancelle, manque de m’évanouir, mais ce bon vieux corps résiste. Je cracherai du sang plus tard. Pour le moment, je vis.
Je me relève lentement. Mes yeux s’habituent à la lumière naturelle. C’est quand même autre chose que celle des ampoules électriques. Comment décrire ce que je n’ai jamais connu autrement que dans les livres ? Très haut, au-dessus de ma tête, ce que l’on doit appeler « ciel » est un plafond mêlé de blanc et de gris. Devant moi, ce que je pense identifier une forêt est recouvert d’une sorte de drap blanc. Non. À regarder de plus près au sol, je parlerai plutôt d’une purée. Une purée dans laquelle mes pieds s’enfoncent et qui me gèle le sang. « Neige ». C’est, je crois, comme ça que ce s’appelle dans les livres.
Derrière moi, la porte s’est refermée sur une immense paroi de pierres qui monte si haut que je n’en distingue pas le bout. Je vois aussi d’anciennes traînées de sang séché. Et au pied, des ossements humains. Un grognement se fait entendre dans la forêt. Je me retourne. Je ne vois rien. Quelle bête sauvage s’y cache ?
Quoi ou qui que ce soit, je suis prêt à l’affronter. Ma respiration désormais est calme. Le froid ne me fait plus trembler. Tranquillement, je ramasse deux tibias au sol, les taille en pointe contre la pierre, et les brandit devant moi, guettant mon adversaire.
Papa, où es-tu ? J’ai fait tout ce que tu m’as demandé pour devenir une personne de valeur. Et me voilà, à l’orée de la mort, dans ce monde froid, si froid. Je suis seul. Qu’ai-je gagné à semer le bien autour de moi ? J’ai peur. Je n’ai pas cédé au mal, papa. Je doute maintenant. Qu’y ai-je gagné, papa ?
J’ai envie de pleurer, maintenant que je suis là. Seul, gelé et apeuré. Un bruissement dans le feuillage, là-bas, devant moi, me rappelle le combat à mener. Comme un gladiateur dans l’arène, pour l’ultime combat de sa vie, j’attends mon ennemi. Qu’y ai-je gagné, papa ? Où es-tu ?
La porte derrière moi s’ouvre soudain. Ils sont une centaine à sortir, à lever les bras pour se cacher de la lumière naturelle et à être pris de soubresauts dans tout le corps. En temps normal, ils paniqueraient, mais de me voir debout et calme, ils se disent que ce n’est pas mortel. Alors, ils résistent.
Timothée s’avance vers moi et me parle d’une voix rauque : « Nous sommes là, Doc. On vous suit. Qu’ils aillent au diable avec leur loterie. Notre rêve, on va le construire ailleurs, et avec vous. »
De la forêt surgit une dizaine de bêtes poilues, à quatre pattes et une longue queue, au museau allongé et les babines retroussées dévoilant des crocs menaçants. « Loups ». Derrière moi, chacun suit mon exemple et s’empare de tibias, de fémurs, de tout ce qui peut servir à frapper ou empaler. Je suis prêt. Nous sommes prêts.
Le seul rêve qui vaut la peine d’être vécu n’est pas celui que l’on attend ou que l’on marchande, c’est celui pour lequel on est prêt à se battre.

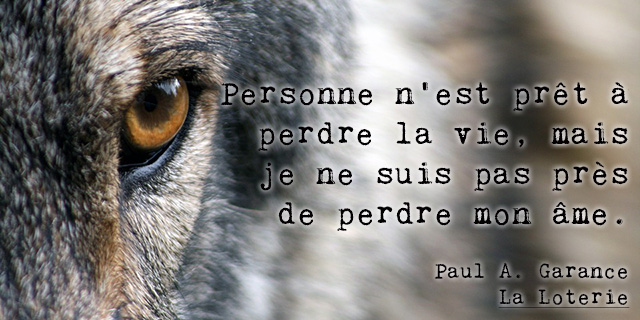



Derniers commentaires